Sebastian Roché, Directeur de recherche au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble, @sebastianjroche
La neutralité du chercheur est-elle possible et souhaitable ?
L’objectivité et la neutralité sont deux concepts bien différents. On doit absolument les distinguer. La neutralité en valeur, l’autonomie par rapport aux valeurs, peut se comprendre de deux manières. D’une part, la neutralité est relative au choix des questions et des objets de recherche ou de la méthode qu’on va retenir pour les étudier : par exemple, veut-on s’intéresser aux causes sociales et économiques de la délinquance ou de la déviance ou plutôt à l’efficacité des patrouilles de police pour les dissuader ? Et va-t-on le faire avec une approche interprétative, en cherchant à comprendre les logiques des personnes, délinquants ou policiers, ou en vérifiant des lois statistiques (par exemple le fait que les enfants mal nourris et qui reçoivent moins d’affection maternelle aient des comportements violents plus fréquent à l’adolescence ?). D’autre part, la neutralité se comprend par la distance avec la prise de position dans les débats publics, donc dans des arènes politiques où les affrontements des partis ou mouvements s’organisent autour de valeurs comme l’égalité, la liberté, ou encore la laïcité récemment promue au rang de valeur.
Est-il possible d’être neutre en valeur dans les deux sens ? Un chercheur pourrait-il ne pas être influencé par l’environnement professionnel, mais aussi social et économique plus large dans lequel il évolue ? C’est simplement impossible. Il n’y a pas de science sociale libre de la prédisposition intérieure, de la subjectivité et de la passion pour leur travail chez les chercheurs. Les jugements de valeurs, et donc les idéaux, ne peuvent être absents du processus de production de la connaissance. Si on peut assigner la neutralité en valeur à une administration, par exemple pour que ses agents traitent chacun indépendamment de son statut social ou de sa couleur de peau, on ne peut pas imposer qu’un chercheur ne soit pas affecté par les questions de société comme la stratification socio-économique ou le traitement différencié selon la couleur de peau. La raison est simple : dans les sciences sociales, les problèmes sociaux étudiés sont des problèmes qui renvoient aux normes et valeurs de la société. Les idéaux à atteindre sont des objets des sciences sociales, qu’il s’agisse de la solidarité ou du libre marché. Lorsque Durkheim étudie les formes de solidarité et le suicide, il est préoccupé par l’intégration sociale en raison du choc de l’industrialisation sur la France de la fin du 19è siècle. Lorsque Weber étudie la formation de la nation allemande, il le fait dans le cadre de l’affirmation des Etats-Nations en Europe.
Se tenir à distance du débat public n’est pas non plus une norme souhaitable. D’abord, parce que les chercheurs produisent une connaissance et ont pour fonction de la rendre publique, de la publier. C’est nécessaire pour alimenter les controverses scientifiques, pour que les arguments puissent faire l’objet de disputes. Ensuite, parce que les chercheurs sont, indépendamment de leur inclination personnelle, sollicités pour donner leur avis, par les pouvoirs publics, mais aussi par les entreprises ou encore la société civile. Les chercheurs diffusent leur travail dans des journaux spécialisés, mais s’ils s’y cantonnent et restent muets en dehors de ce cadre, leur travail sera peu connu des décideurs et du grand public, et donc peu utile.
Comment définiriez-vous l’objectivité en sciences sociales ?
Si la neutralité en valeur n’est ni réalisable ni désirable, le fait de s’engager en valeur pour une cause qu’on estime juste ne donne pas raison. On peut dénoncer le défaut de solidarité, les entraves au libre marché, les inégalités entre hommes et femmes, mais un engagement ne donne ni a priori raison sur le fait que ces différents faits sont attestés, ni n’équivaut à en avoir montré les causes. De même, une position moyenne ou modérée n’est pas une meilleure garantie d’objectivité qu’une position plus tranchée, même si elle peut être plus acceptable socialement ou politiquement.
L’engagement du chercheur est nécessaire, et il est mieux encadré par des règles éthiques aujourd’hui. Vouloir influencer la réalité sociale, économique, ou les politiques policières d’un pays n’est en rien contraire à l’objectivité du chercheur, à condition de distinguer les faits et les jugements de valeur. Certains auteurs ont défendu qu’il n’y avait pas de différence entre les faits et les jugements, c’est un débat trop long à traiter ici, mais je ne suis pas convaincu par leurs arguments : moins les différencier ne permet pas de produire une meilleure science. L’objectivité repose, précisément, sur la possibilité de séparer les faits et les valeurs. D’autres ont défendu que le travail du chercheur n’était pas d’améliorer la société. C’est étrange : s’il est légitime de chercher un vaccin contre la rage et aujourd’hui contre le Covid pour éviter les souffrances et décès, il est tout autant légitime de proposer des nouveaux modes de scrutin qui représentent mieux la diversité de la population et donc la cohésion, ou des doctrines de maintien de l’ordre afin d’éviter que la police mutile les protestataires.
L’objectivité consiste à mettre des interprétations à l’épreuve des faits, et à convaincre que la manière de réaliser ce test est convaincante. Si le darwinisme, la théorie de la biologie évolutionniste, est vrai, alors on doit pouvoir organiser les faits observés dans le cadre de cette théorie, en tous les cas mieux que dans celui d’une autre théorie comme le créationnisme. Je pense qu’il en va de même en sciences sociales. Si, dans le domaine que je connais, on défend la thèse suivant laquelle la police remplit une fonction de reproduction des inégalités socio-économique, et nulle autre, on doit être capable d’organiser les faits dans ce cadre. Si on défend l’idée que la police est un service public neutre, indifférent à la richesse ou la couleur de peau, on doit pareillement être capable de rendre compte de la réalité observée en fonction de ce cadre. Or, il apparaît impossible de dire qu’aucune des deux interprétations n’est complètement juste ou complètement fausse. Il y a d’autres exigences. Par exemple, il faut que la précision des propositions théoriques testées soit suffisante (il faut préciser qu’est-ce que l’inégalité devant le service par exemple), l’organisation temporelle des variables démontrée (par exemple, est-ce que la violence policière vient avant la violence contre les policiers ?), et la causalité prouvée (par exemple, la violence contre les policiers est-elle la cause de la discrimination ethnique chez les policiers ?).
Quelle place les méthodes occupent-elles dans votre démarche de chercheur ?
La qualité des méthodes de collecte des données et la réflexion sur les outils et les plans d’expérience pour tester les interprétations sont deux préoccupations. J’ai probablement longtemps mis l’accent sur la première dimension, la collecte, dans le but de mesurer des phénomènes. Je me suis plus confronté plus tardivement à la discussion des interprétations générales, à savoir si les données permettaient de trancher entre différentes théories. Et, incidemment, je note que le problème en sciences humaines est autant de produire les théories que de produire les données.
Etant donné la sortie du grand paradigme interprétatif qu’était le marxisme, dont j’ai uniquement vu la queue de la comète en tant que tout jeune chercheur, et le fait qu’aucun autre ne l’a remplacé, il y a aujourd’hui de très nombreuses théories partielles, mais plus de cadre théorique d’ensemble. Contrairement à ce que disent les critiques de l’idéologisation supposée des sciences sociales, et donc de la science politique, la vérité qui colle le mieux avec les faits empiriquement observables, la tendance va dans la direction opposée. Il y a certes des sensibilités en valeur qui évoluent, notamment sur la question de l’égalité des droits des personnes avec une attention donnée aux autres inégalités que celles de statut socio-économique. Mais, on constate plus de tests empiriques des propositions théoriques par différentes méthodes que par le passé en sciences sociales en France. Le nombre des publications et la place donnée à la présentation des résultats dans les journaux scientifiques en témoignent. L’objectivité a progressé tout comme les méthodes. De ce point de vue, il est préoccupant d’observer que des responsables politiques peuvent valoriser plus comme source d’information sur la délinquance les propos d’un boucher charcutier de Tourcoing que les études de l’Insee. Ce qui a fait tiquer (et donc tweeter) le directeur de ce vénérable organisme.
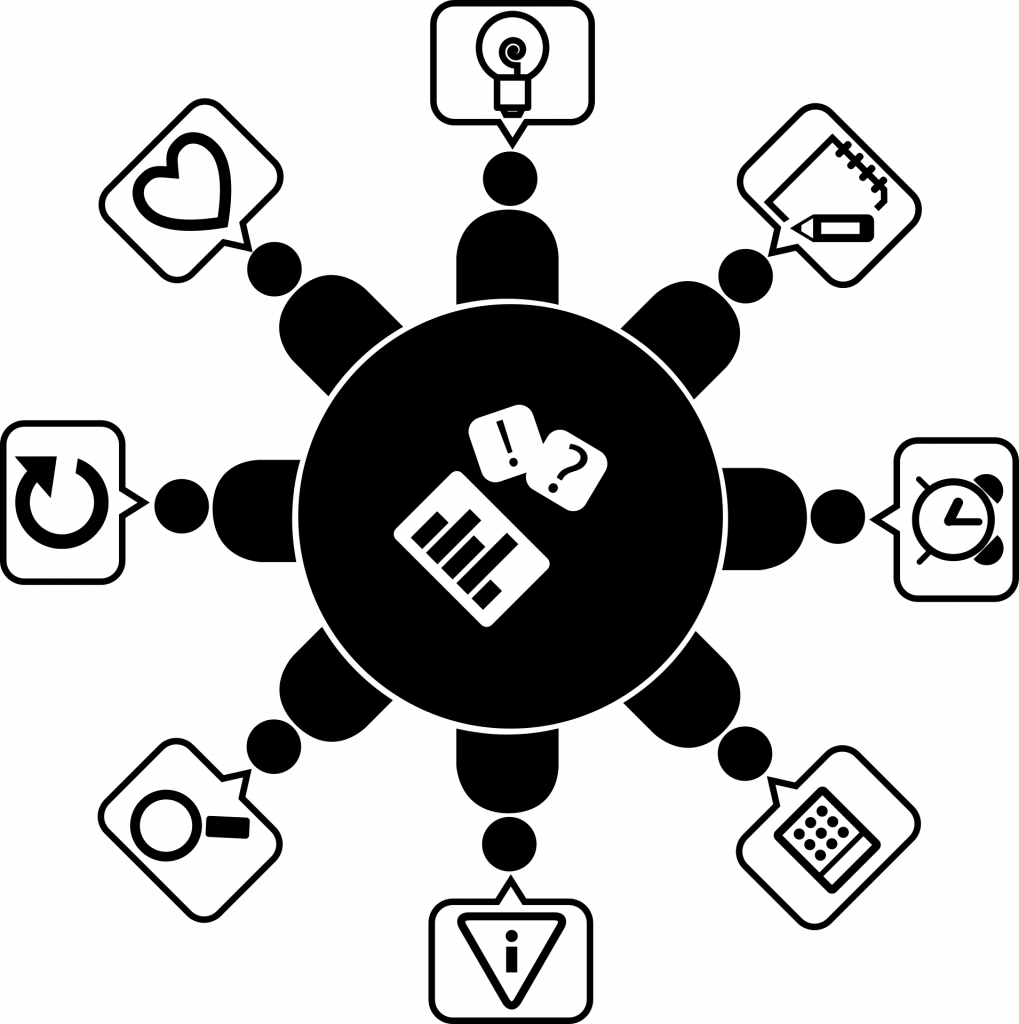
Concernant les méthodes, je me suis intéressé à deux choses. D’abord, la collecte des informations sur la délinquance, et les contacts avec les policiers. Dans les deux cas, l’idée était de trouver des méthodes de dénombrement fiables, et ceci supposait de s’affranchir de la statistique administrative (la délinquance enregistrée par la police, les contacts avec les policiers dénombrés par les policiers). Puis, pour comprendre pourquoi les policiers sont plus violents en France qu’en Allemagne, je me suis intéressé aux systèmes de régulation des comportements des policiers (avoir une cour constitutionnelle ou non ; être organisé centralement ou localement par exemple). Si les notions de configuration de variables et de réseaux institutionnels semblent prometteuses pour expliquer les différences, je n’ai pas la réponse. Les méthodes pour compter ou pour décrire les environnements institutionnels progressent nettement, mais lentement.
Pourriez-vous présenter un exemple de recherche, idéalement issue de vos propres travaux, pour illustrer les enjeux et les tensions autour de l’objectivité et de la neutralité en sciences sociales ?
Je vais prendre le débat, très polémique, sur l’existence des contrôles d’identité au faciès par la police. D’un côté, les responsables politiques et les directions centrales de la police affirment que la police n’est pas « raciste », au sens ici d’une discrimination c’est-à-dire d’un traitement pus défavorable des personnes qui n’appartiennent pas à l’ethnie majoritaire apparente (les apparences physiques). Le fait que ces responsables ne disposent d’aucun élément pour étayer leur assertion fait douter de sa véracité. Pour autant, il faut pouvoir tester cette proposition de manière rigoureuse, et notamment en tenant compte du quartier où ont lieu des contrôles, du type comportement des personnes contrôlées et en particulier de la commission d’une infraction.
Il faut aussi conceptualiser la question pour organiser la vérification. Par exemple, est-ce que la « disponibilité au contrôle de police » doit être considéré lorsqu’on veut mesurer la possibilité d’une discrimination ethnique par la police ? Le fait qu’une personne soit dans la rue plus souvent élève son risque de contrôle, et si cette pratique est plus fréquente dans le groupe minoritaire, le sur-contrôle policier reflète-t-il la discrimination policière ou le style de vie minoritaire ? De même, est-ce qu’un policier est discriminatoire s’il réalise les contrôles demandés par le procureur de la République dans une zone pauvre et où résident de nombreuses personnes appartenant à la minorité ethnique ? Grâce à des méthodes de test quasi-expérimentales (avec une comparaison entre groupes dans les mêmes conditions), ou par le contrôle des types de vérification d’identité, on vérifie que la disponibilité au contrôle ou le fait que le contrôle du lieu soit demandé par un juge ou non, on vérifie que la discrétion de l’agent, c’est-à-dire sa capacité à choisir la cible du contrôle, reste entière, et qu’ils l’exercent au détriment des groupes minoritaires.
Les tests empiriques conduits par des collègues et par moi-même depuis une dizaine d’années en France ont permis de montrer que les personnes d’origine africaine, subsaharienne ou nord africaine, sont plus contrôlées, et ce quels que soient la classe d’âge et le genre, même si le phénomène est plus marqué pour les jeunes garçons. Mais également que le contrôle au faciès a lieu aussi bien à l’intérieur des ZUS (zones urbaines sensibles, les banlieues pauvres) qu’à l’extérieur des ZUS, et notamment au centre-ville. L’écart entre le contrôle des blancs et des non-blancs est vrai dans les zones pauvres, et il se révèle même plus fort dans les lieux où la minorité est la moins représentée, comme par exemple à Paris à la descente du Thalys en provenance de Londres. Pour s’assurer que le comportement délinquant est pris en compte dans la dynamique du contrôle d’identité, on a greffé des modules portant sur l’expérience du contrôle d’identité sur des enquêtes dites de « délinquance auto-déclarée » qui permettent de bien mesurer l’implication délinquante des jeunes. On a pris en compte ces variables dans les analyses. Il apparaît que les enfants, dès l’âge du collège, sont sujets à un sur-contrôle par la police. Les enquêtes POLIS et UPYC, à Marseille, Aix-en-Provence, Lyon ou Grenoble l’ont montré. Au total, sur dix années, l’ensemble des enquêtes nationales et locales ont montré, pour tous les services de police quelque soit le lieu étudié, une discrimination ethnique.
Les résultats des études des organismes de défense des droits ou des universités, du CNRS, de l’INED, de Sciences Po Grenoble ne sont pas pour autant acceptés par les pouvoirs publics. La rigueur et la répétition des tests ne parviennent pas à convaincre. L’argument avancé pour le rejet est de nature morale : on est soit avec la police, soit contre la police. Observer des pratiques illégales serait donc immoral. C’est donc au nom d’un engagement moral que certains se donnent le droit d’ignorer des résultats objectifs. Voilà une illustration intéressante de la tension entre valeurs et objectivité.