Anne Bartel-Radic, Professeure en sciences de gestion à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CERAG
Comment définiriez-vous l’objectivité dans votre discipline ?
L’objectivité, c’est d’expliciter dans quelle mesure on est subjectif en tant que chercheur. Les sciences sociales s’intéressent à l’Humain et à la vie en société – dont nous sommes en même temps parties prenantes en tant que personnes et en tant que chercheurs. Quelle que soit la finalité d’une recherche, ou le sujet, on n’est donc jamais parfaitement neutre, on n’est jamais entièrement extérieur au sujet. Nous naissons tous dans un pays, un continent, une époque, un milieu social particulier, et nous développons à travers nos expériences, notre parcours : en découlent forcément des opinions, des attitudes, des émotions vis-à-vis de nos objets de recherche, l’Humain et comment il fait société. S’interroger sur nos pré-supposés face à nos sujets, et en rendre compte, est selon moi un premier pas pour assurer, sinon l’objectivité, du moins la scientificité de nos travaux.
Les Sciences de gestion et du management se définissent par le fait qu’elles sont des « sciences de l’action », de la même manière que les sciences de l’ingénieur. Nos recherches ne visent donc pas seulement à décrire, comprendre, expliquer le fonctionnement des organisations ; nous tentons aussi de formuler des recommandations pour l’action, pour les acteurs qui « gèrent » des organisations, qu’elles soient publiques, privées ou associatives. Pour cela, les sciences de gestion et du management puisent très fortement dans différentes sciences « voisines » des sciences humaines et sociales, comme la sociologie et la psychologie, l’économie, l’anthropologie et, dans une moindre mesure et sans que cette liste soit exhaustive, l’histoire, le droit ou la science politique. Nous en adoptons des cadres théoriques, donc des résultats de recherche fondamentale, mais aussi des méthodes – tout en les appliquant à des questions relatives au management des organisations et des acteurs dans ces organisations.
Se pose alors la question de savoir comment assurer l’utilité des recherches. Cela passe d’abord par la formulation de la problématique : dès le départ d’une recherche, nous explicitons non seulement les contributions conceptuelles attendues, mais également les difficultés pratiques que les résultats devraient aider à résoudre. Mais les chercheurs en sciences de gestion et du management ne sont absolument pas des consultants qui permettent par leurs travaux à des entreprises d’augmenter leurs bénéfices.
C’est la question de l’impact des recherches qui se trouve de plus en plus sur le devant de la scène. L’impact visé est beaucoup plus large : comment faire pour que les organisations contribuent aux grands enjeux sociétaux ? Les associations scientifiques, comme par exemple la European Academy of Management (EURAM) affichent explicitement, pour chacun des groupes d’échanges de sa conférence annuelle, les 17 objectifs de développement durable de l’ONU auxquels les recherches présentées contribuent. Les objectifs de « travail décent et croissance économique » tout comme « industrie, innovation et infrastructure » ou encore « collaborations pour la réalisation des objectifs » sont très largement visés par la recherche en sciences de gestion, mais la discipline couvre l’intégralité des enjeux, environnementaux, de santé et sociaux.
La neutralité du chercheur est-elle possible et souhaitable ?
Cette question anime les débats entre chercheurs depuis les origines de la discipline. Il s’agit de la « posture épistémologique » du chercheur, exercice incontournable et parfois craint dans toute thèse de doctorat en Sciences de gestion et du management. Au sein du champ du management interculturel, plusieurs collègues dont Christoph Barmeyer qui est venu à Sciences Po Grenoble en septembre 2019 en tant que professeur invité, ont publié un article dans lequel ils regroupent les travaux dans le champ dans quatre paradigmes.
Le paradigme positiviste vise une connaissance objective, indépendante du chercheur. Les résultats obtenus doivent pouvoir être reproduits par d’autres chercheurs qui réaliseraient la même étude. Les recherches positivistes en management interculturel considèrent les cultures nationales comme indépendantes les unes des autres, et les abordent au prisme de dimensions qui permettent d’identifier et de quantifier des différences culturelles. Ce courant a engendré des publications très nombreuses, mais il est aussi de plus en plus critiqué.
Le paradigme interprétatif voit les cultures comme des interprétations partagées par les membres d’un groupe, développées grâce à l’interaction au sein de ces groupes et transmises par la socialisation aux nouveaux venus. Cet « autre grand paradigme » du champ du management interculturel mène surtout des recherches qualitatives qui permettent de montrer les particularités d’une culture et comment elle influence le management des organisations. Les études observent le caractère unique d’une culture (ancrée dans l’histoire), mais aussi les influences mutuelles (par exemple dans la globalisation), les évolutions (au fil des générations et des innovations, comme le numérique) et la complexité de multiples niveaux de culture (le milieu social, des organisations, régionale, religieuse… aux côtés du niveau national).
Le paradigme postmoderne, aussi appelé constructiviste par ailleurs, met l’accent sur le langage et le discours, et montre comment des « réalités » en émergent localement et temporairement. Une étude de fusions-acquisitions entre des entreprises suédoises et finlandaise a ainsi montré comment les différences culturelles entre les deux pays n’engendrent pas « automatiquement » des difficultés d’intégration des deux entreprises qui fusionnent. C’est selon la manière dont les acteurs évoquent et mobilisent les différences culturelles dans leurs discours que celles-ci sont constatées, et vues comme une richesse ou plutôt une difficulté.
Le paradigme critique, enfin, pose explicitement la question du lien entre culture et pouvoir. Il voit la culture nationale comme un discours faisant s’opposer des dominants et des dominés, potentiellement résistants face à cette domination. Au sein des organisations, les recherches critiques considèrent la hiérarchie comme absolument non neutre. On observe alors que dans une entreprise qui affiche le souhait d’inclure la diversité culturelle dans ses projets, la réalité du management aboutit plutôt à écarter les points de vue divergents.
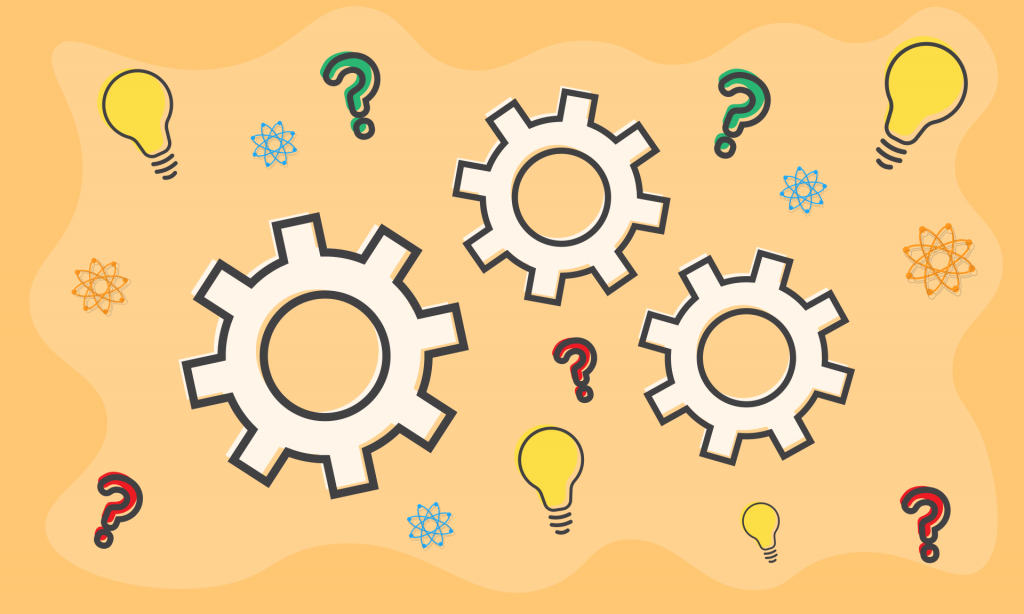
Pour conclure par la réponse à la question posée : la neutralité du chercheur est possible, mais elle n’est pas souhaitée dans tous les paradigmes. Le positivisme et l’interprétativisme visent à décrire une réalité indépendante du chercheur, alors que les partis-pris des chercheurs sont revendiqués dans les paradigmes postmoderne et critique.
Quelle place les méthodes occupent-elles dans votre démarche de chercheur ?
Il n’y a pas de science sans méthodes. Celles-ci occupent donc une place absolument essentielle dans mes recherches. Je mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives, et j’aime varier les méthodes, voire innover en la matière.
Une méthode de recherche très courante en sciences de gestion et du management est celle des études de cas qualitatives. Une organisation, une entreprise, une équipe ou un projet sont abordés comme un « cas » sur lequel on collecte un maximum d’informations qui sont soit déjà publiques, à travers la presse ou la communication faite par l’entreprise, soit recueillies par les chercheurs, à l’aide d’entretiens avec des membres de l’organisation ou encore l’observation directe de leur travail ou échanges. On réalise ensuite une analyse des contenus des textes ainsi constitués. Il peut s’agir de l’étude d’un cas unique, alors très approfondi, ou alors de comparaisons de cas multiples qui reposent parfois sur la quantification des caractéristiques clés des cas.
Les méthodes quantitatives, en sciences de gestion et du management, reposent souvent sur des collectes de données par questionnaires. L’unité d’analyse est alors les individus, souvent en tant que consommateurs, ou de salariés. J’ai mobilisé cette méthode pour savoir si l’expérience internationale augmente la compétence interculturelle. Comme la réponse était mitigée, je continue à creuser la question de savoir comment l’expérience internationale permet de développer ces compétences, notamment à travers l’étude menée depuis 2017 auprès des étudiants de Sciences Po Grenoble à la fin de leur année de mobilité internationale. Comme dans mes recherches précédentes, nous utilisons dans ce questionnaire la technique des incidents critiques pour mesurer si les répondants comprennent et interprètent correctement des situations interculturelles. Nous étions loin de nous douter aux débuts de l’étude qu’en 2020, la pandémie de COVID-19 bouleverserait nos vies, et les mobilités internationales de nos étudiants – en fournissant néanmoins un contexte d’étude particulièrement intéressant, permettant d’aboutir à des compréhensions nouvelles.
Mais les questionnaires auto-administrés et les entretiens semi-directifs comportent le risque de biais de réponse : les personnes interrogées peuvent s’y présenter sous un jour qu’elles jugent plus favorable, et rationaliser les situations a posteriori. De plus, les questions sont généralement décontextualisées et décorrélées de contraintes contradictoires. Au sein du projet InterCCom que je porte, nous avons développé une méthodologie de recherche innovante, qui mobilise des jeux sérieux numériques en tant qu’expérimentations. Hamza Asshidi a ainsi créé dans le cadre de sa recherche doctorale un jeu pour mener une expérimentation sur les comportements responsables en entreprise. On assigne aux joueurs le rôle de salarié(e)s dans une entreprise multinationale. Ils doivent accomplir différentes tâches : prendre contact avec un prospect en Turquie, recruter un nouveau collaborateur, superviser la mise en place d’une nouvelle ligne de production au Nigeria ou encore contrôler les finances d’une filiale en Colombie. Le tout sous les ordres du manager M. Smith, qui ne cesse de rappeler des impératifs de performance et de budget. Chaque situation aborde en fait une dimension de la responsabilité sociale des entreprises selon l’ISO 26000. Cette recherche a permis de montrer la relative inutilité d’un code de (bonne) conduite signé à l’embauche pour orienter les comportements des salariés – résultat qu’on n’aurait probablement pas obtenu en interrogeant des salariés ou leurs managers ! Tout l’intérêt des expérimentations est de mettre les participants en situation, avec toutes les contraintes que cela implique.
Pourriez-vous présenter un exemple de recherche, idéalement issue de vos propres travaux, pour illustrer les enjeux et les tensions autour de l’objectivité et de la neutralité dans votre discipline ?
Une des notions au centre de mes recherches est la compétence interculturelle. La compétence interculturelle est la capacité de comprendre les spécificités des interactions interculturelles, et de s’adapter à cette spécificité. Le débat sur l’évaluation de ces compétences révèle les enjeux et tensions autour de l’objectivité et de la neutralité. Au préalable de toute recherche ou prise de position, il convient de s’interroger sur les raisons d’être et les objectifs de l’utilisation des instruments d’évaluation. Dans quels contextes et à quelles fins cherche-t-on à évaluer la compétence interculturelle ? Dans le contexte du management et des organisations, trois configurations principales coexistent.
La première utilisation des instruments de mesure de la compétence interculturelle a lieu dans les entreprises et organisations. Dans une logique de gestion des ressources humaines et dans des contextes de recrutement, d’affectation de tâches ou de promotion interne, on cherche à savoir si une personne possède une compétence interculturelle considérée comme requise pour le poste en question ou à l’occasion de bilans d’atteinte des objectifs ou de compétences. Il existe souvent un enjeu de carrière important, et les avis peuvent diverger !
Une deuxième utilisation des outils de mesure de la compétence interculturelle est une utilisation individuelle, personnelle. L’individu s’auto-évalue, dans une logique de connaissance de soi, d’orientation professionnelle et d’apprentissage. Il est alors souhaitable que cet outil offre, outre la possibilité d’évaluation, des voies pour l’apprentissage.
Enfin, les outils de mesure de la compétence interculturelle sont utilisés par les chercheurs qui questionnent, entre autres, les conséquences de la compétence interculturelle, sur la performance ou le leadership d’équipes internationales ou sur la création de liens entre filiales d’une entreprise multinationale. Ce qui importe ici est la scientificité des instruments, et leur cohérence avec le cadre épistémologique et méthodologique de l’étude.
La compétence interculturelle est un concept complexe et multidimensionnel qu’on ne peut évaluer sans s’interroger au préalable sur sa définition. Il est fondamental de clairement déterminer quels aspects de la compétence interculturelle on souhaite évaluer. Une compétence « culturelle » spécifique à une culture particulière ? Une compétence « multiculturelle », une connaissance générale des dimensions culturelles ? Si la compétence interculturelle englobe bien tous ces aspects, aucun outil ne permet d’en tenir compte dans sa globalité.
L’évaluation de la compétence interculturelle pose les mêmes questions que celle de la compétence individuelle en général : il s’agit d’un concept abstrait qui ne peut pas être observé directement. Il existe notamment trois entrées possibles pour évaluer la compétence. La première est l’approche par la performance : on juge alors l’efficacité́ de la personne et on en déduit sa compétence. Ainsi, on pourrait juger de la compétence interculturelle d’un cadre par son degré de performance dans son travail à l’international. Mais compétence et performance ne sont pas la même chose, de nombreux autres facteurs influant sur la performance.
La deuxième approche est la verbalisation – instantanée ou différée – de l’action qui donne accès aux schèmes opératoires construits par la personne pour réaliser l’action. La verbalisation de la compétence interculturelle implique de « faire parler » l’individu de ses interactions interculturelles, de sa vision des différences culturelles qu’il rencontre, de ses émotions lors de ces situations. Aborder la compétence interculturelle sous cet angle permet de tenir compte de sa singularité, de sa spécificité selon les personnes et les cultures. En revanche, une telle approche demande beaucoup de temps, ne peut être faite que par des chercheurs eux-mêmes experts des relations interculturelles et des cultures en présence. Elle n’est pas compatible avec une posture épistémologique visant une parfaite neutralité du chercheur. Enfin, la compétence se mesure par le degré de conformité de l’activité à des spécifications ou des standards. Cela sous-entend qu’il existe des « recettes » à appliquer pour la communication interculturelle ; ce qui est une vision réductrice. Néanmoins, des recherches reposant sur la mise en situation des participants, à l’aide « d’incidents critiques » voire de jeux sérieux, ont également des avantages considérables que nous exploitons dans nos travaux.