Marieke Louis, Maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte,@marieke_lisbeth
Comment définiriez-vous l’objectivité en sciences sociales ?
Pour moi, la recherche de l’objectivité implique d’abord une mise à distance de notre subjectivité et de celle des autres. Tous les scientifiques, indépendamment de leur discipline, entretiennent un rapport situé au monde, de par les milieux dans lesquels ils ont été ou sont actuellement socialisés. Ces liens, en tout genre, peuvent susciter des biais : les plus fréquents étant le biais dans la manière de sélectionner les informations à notre disposition, ou le biais consistant à hiérarchiser les sujets entre eux en fonction d’une échelle de valeurs qui nous est propre, à nous ou à notre groupe de référence. En principe, un peu d’introspection et de réflexivité devraient suffire à surmonter ces biais, mais comme il n’y a pas vraiment de consensus quant au fait que nos socialisations et nos engagements divers puissent potentiellement être un problème pour l’objectivité de nos travaux, chacun fait un peu comme il veut.
Malgré cela, on peut néanmoins s’accorder sur le fait que l’objectivité implique la confrontation des points de vue (de tous les points de vue) aux faits et aux théories, la mise en débat et l’évaluation de nos travaux par nos pairs (d’où l’importance de la composition des comités éditoriaux et de rédaction des revues ou maisons d’édition), mais aussi par un public plus large, sensibilisé à la démarche scientifique, ce qui est encore loin d’être le cas dans l’espace public, y compris dans les médias.
Prétendre à l’objectivité nécessite surtout de douter. Pas de tout et de n’importe quoi comme dans les mal nommées « théories du complot », mais de douter de notre capacité à « avoir absolument raison ». Il me semble qu’il y a deux types de postures excessives dans la recherche qui nous éloignent de l’objectivité: celle qui consiste à prétendre tout savoir, et celle qui consiste à douter de tout, tout le temps. C’est ce doute raisonnable (et non pas existentiel) et cette curiosité qui nous poussent à lire les travaux des autres, y compris d’autres disciplines et sous-champs, qui nous permet d’intégrer les positions et les travaux qui ne correspondent pas forcément à notre interprétation des faits, et enfin à les discuter plutôt qu’à les disqualifier d’un revers de main ou dans une note de bas de page.
A cet égard, je préfère sincèrement une controverse un peu intense sur des questions communes, à l’indifférence ambiante pour les travaux des autres. Cette indifférence, j’en fais régulièrement l’expérience en tant que membre du comité de rédaction de la revue La Vie des idées, notamment dans la difficulté à trouver des chercheuses et chercheurs qui acceptent d’écrire des recensions des ouvrages de leurs collègues (recensions que tout le monde réclame par contre pour son propre travail…). A ce titre, je pense que certaines manières d’évaluer la recherche, notamment celles qui mettent une pression constante à la publication en nom propre, sont contreproductives et risquent de nous faire perdre en objectivité, en nous encourageant à la sur-spécialisation et à la constitution de niches de savoirs qui s’ignorent davantage qu’elles ne se confrontent les unes aux autres.
La neutralité du chercheur est-elle possible et souhaitable ?
Oui, surtout en ce moment, dans un contexte où la science est dans une situation paradoxale : constamment sollicitée (le savoir est bel et bien un déterminant du pouvoir, comme l’avait identifié Foucault) et constamment remise en cause et disqualifiée. Personnellement, je vois dans la facilité qu’ont les détracteurs et détractrices des sciences sociales à discréditer notre travail en ce moment, un véritable échec collectif. Celui-ci devrait nous alerter et nous mobiliser comme corps professionnel, moins dans des prises de position politiques de soutien à tel ou tel candidat ou parti, mais autour de la défense des valeurs de notre métier.
Je ne prétends pas renouveler les débats sur la neutralité axiologique. Je laisse la parole à toutes celles et ceux qui ont consacré une bonne partie de leur œuvre à réfléchir précisément à cette question, et dont je trouve dommage voire dangereux qu’on « bazarde » actuellement l’héritage en cherchant constamment à montrer qu’ils ou elles avaient un « intérêt bien compris » à plaider en faveur de cette neutralité et donc qu’ils ou elles n’étaient absolument pas neutres. J’évoquerai donc ici surtout mon rapport à la neutralité, en tant qu’enseignante-chercheuse.
Pour moi, la neutralité est une éthique professionnelle. C’est notre serment d’Hippocrate à nous. Sans même parler du fait que nous sommes pour la plupart des fonctionnaires (et que des obligations sont donc attachées à ce statut), la neutralité est avant tout pour moi un engagement vis-à-vis de la science et de l’aspiration à produire des savoirs objectifs, mais aussi, et surtout, un engagement vis-à-vis du public, à commencer par nos étudiant.e.s, pour qu’ils et elles aient confiance dans les savoirs que nous leur transmettons. Un engagement pour qu’ils ou elles ne puissent pas penser ou affirmer qu’en lieu et place de connaissances, nous leur avons transmis de l’idéologie (quelle qu’elle soit). C’est en partie pour cette raison qu’il me semble important d’enseigner les idées politiques et la manière dont sont produites des idéologies, pour donner aux étudiant.e.s la possibilité d’exercer leur faculté de discernement sur les frontières, parfois labiles, entre production de savoirs scientifiques et idéologie. Or, la théorie politique en général tend à disparaître des programmes, y compris dans les instituts d’études politiques, et c’est à mon avis dommageable.
On dit souvent que la neutralité s’oppose à l’engagement. Je pense au contraire que la neutralité est une forme d’engagement : un engagement professionnel. Et pas des plus simples, parce qu’il implique de faire preuve de retenue, y compris lorsque certaines situations nous révoltent ou, tout simplement, mettent nos convictions à l’épreuve. Cela implique aussi parfois de lutter contre les élans de notre subjectivité. Pour moi, être neutre ne signifie pas être détachée du monde social, c’est au contraire être en état de « vigilance constante » comme dirait l’autre…
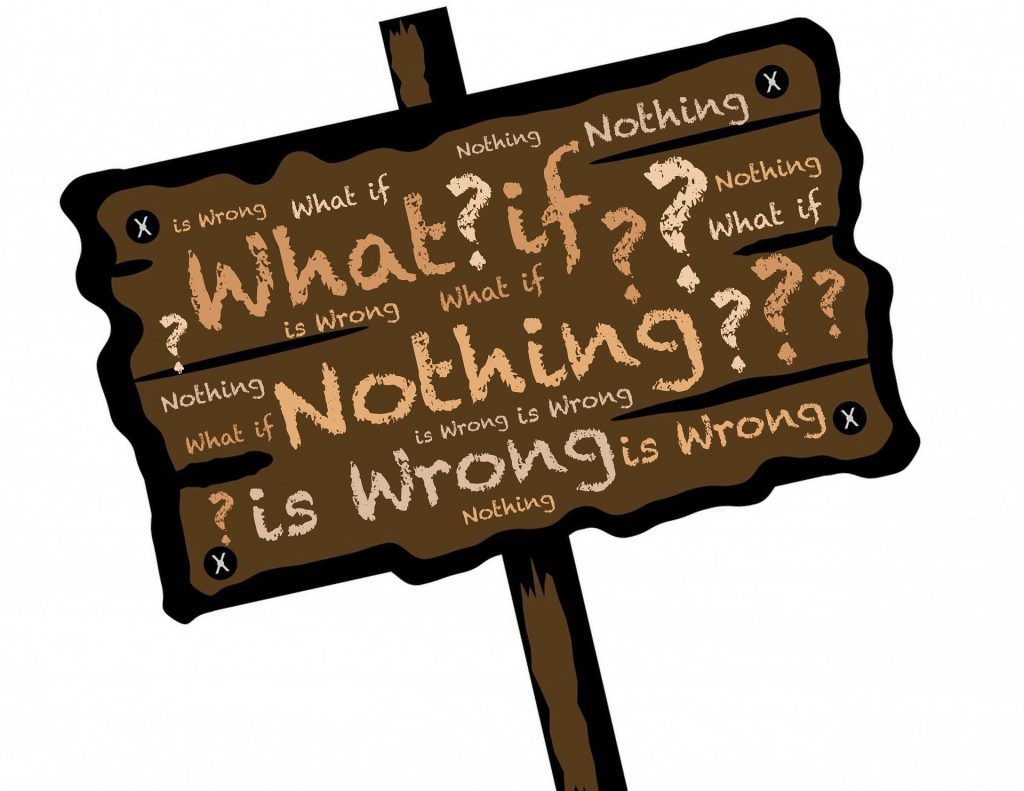
Et être neutre dans son travail, ne signifie pas être neutre en toutes circonstances. Dès lors, être neutre nécessite surtout de discerner les différents espaces d’intervention, et c’est sans doute le plus difficile aujourd’hui, dans des sociétés où les frontières entre les espaces et les registres d’intervention sont mouvantes. On le voit avec l’expertise par exemple, qui devient indispensable, et je pense que c’est tant mieux, en matière de politiques publiques. C’est notamment ce qu’on explore en ce moment avec l’Association française de science politique dans la série de podcasts Politistes dans la Cité.
En ce qui me concerne, faire le choix d’être enseignante-chercheuse, c’était aussi renoncer à d’autres types de carrières : militante, journalistique ou artistique. Et si je pense que le dialogue entre les espaces d’intervention dans la Cité et les différentes professions est nécessaire, leur (con)fusion me semble problématique. Il faut donc être prudent dans certains engagements, surtout lorsqu’ils sont publics et aisément « récupérables » dans l’espace non-scientifique.
Quelle place les méthodes occupent-elles dans votre démarche de chercheur ?
J’accorde une grande importance aux méthodes dans mes recherches, parce que celles-ci constituent la preuve sinon de mon objectivité, du moins des efforts que je fais pour être objective ! Pour le dire autrement, s’il est parfois difficile d’être objectif, on peut néanmoins faire preuve d’objectivité via la transparence sur ses méthodes de recherche, comme une forme de traçabilité de notre « produit ». J’ai été tardivement formée aux méthodes des sciences sociales, seulement pendant ma thèse, précisément parce que nombre de mes formateurs considéraient (et ils n’avaient pas forcément tort), « qu’une bonne méthode ne remplacerait jamais une bonne question, et encore moins une bonne idée » (!)
Néanmoins, si j’accorde sans doute plus de valeur à la découverte et à une bonne intuition qu’à l’instrument et à la technique, nos méthodes, qu’elles soient plutôt qualitatives ou quantitatives (je suis, comme d’autres, assez sceptique quant à l’utilité de cette distinction), font aussi notre plus-value et garantissent une forme d’objectivité. Les méthodes que je mobilise sont l’observation, l’analyse d’archives, la conduite d’entretiens, dans une perspective socio-historique, qui prête attention au temps long, et aux transformations « profondes » du corps social. Ce sont des méthodes particulièrement « réactives » au sens où les résultats qu’on en tire doivent beaucoup à notre interprétation. Leur validation nécessite de nombreux croisements et recoupement avec d’autres sources. Mais c’est aussi ce qui rend la chose intéressante.
En outre, sans maîtriser l’analyse statistique, j’accorde aussi une attention à la quantification des phénomènes que j’étudie : j’ai notamment beaucoup travaillé pendant ma thèse sur les écarts de représentation entre pays et mouvements dans les organisations internationales ce qui m’a obligée à « compter » attentivement un certain nombre de situations, et à les mettre en forme graphiquement. Cela m’a notamment conduit à nuancer certains discours sur la sous- ou sur-représentation de certains groupes. Le problème de la seule quantification, c’est qu’elle laisse aussi l’interprétation ouverte : les chiffres ne parlent jamais d’eux-mêmes. En ce moment, j’investis davantage les méthodes dites prosopographiques pour reconstituer des phénomènes de réseaux, et surtout, j’essaie de mobiliser davantage le réflexe comparatif. Bref, je n’ai pas de religion en matière méthodologique. Il me semble que c’est la question de recherche qui doit guider le choix de la méthode et non l’inverse (même si j’ai bien conscience qu’on ne peut pas maîtriser toutes les méthodes). C’est notamment ce que j’ai retenu d’un professeur que j’ai rencontré lors d’un séjour d’études à la London School of Economics et qui reprochait à un doctorant qui mobilisait les concepts foucaldiens à tout va, de vouloir absolument « planter un clou avec un tournevis ».
Pourriez-vous présenter un exemple de recherche, idéalement issue de vos propres travaux, pour illustrer les enjeux et les tensions autour de l’objectivité et de la neutralité en sciences sociales ?
Je vais prendre une certaine liberté avec la question, et utiliser un exemple issu non pas de mes travaux sur les organisations internationales, mais d’un enseignement que je donne depuis plusieurs années à Sciences Po Grenoble intitulé « Between Fiction and Politics : (Mis)Representations of the United Nations in literature and movies », et qui m’a demandé d’effectuer beaucoup de recherches en amont ! Tout l’enjeu de ce cours est précisément de sensibiliser et de travailler, avec les étudiant.e.s, les questions d’objectivité et de subjectivité dans un contexte de production de savoirs tantôt concurrents, tantôt complémentaires, tantôt contradictoires, autour du cas des Nations unies et des relations internationales en général.
La question que je leur pose d’entrée de jeu est la suivante : « Pourquoi lire de longs articles scientifiques sur les relations internationales et le fonctionnement des organisations internationales, alors qu’on a à notre disposition d’autres sources beaucoup plus attirantes comme les films, les séries, les romans, les documentaires qui nous apportent aussi des réponses à des questions fondamentales comme la guerre et la paix ? » Outre qu’il me tient à cœur de démontrer la plus-value des sciences sociales (et je parle bien de plus-value et non de supériorité), dans l’analyse des relations internationales, j’utilise notamment ce cours pour sensibiliser les étudiant.e.s à la confrontation de manières différentes, et parfois concurrentes, de produire des savoirs et des jugements sur les faits sociaux, à commencer par « l’échec » de la coopération internationale en cas de guerre ou de génocide.
J’utilise une méthode similaire lorsque je demande aux étudiantes et étudiants de faire une revue critique d’actualité à partir de la lecture des médias. L’idée est aussi de leur faire comprendre que si leur lecture du monde était en tout point conforme à celle qu’on lit dans tel ou tel journal ou qu’on regarde dans un documentaire, aussi sérieux soit-il, alors une formation en sciences sociales ne servirait pas à grand-chose.