Fabien Terpan, Maître de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CESICE, @TerpanFabien
Comment définiriez-vous l’objectivité en sciences sociales ?
Schématiquement, on peut distinguer deux grandes approches au sein de la discipline juridique, et plus particulièrement au sein du droit public. Soit le droit est une science dont l’objet d’études est le droit, et uniquement le droit ; soit elle est une science qui entend analyser le droit en relation avec la société qui l’entoure.
Pour les tenants de la première approche, il existe une logique du droit qu’il convient d’analyser indépendamment de la réalité sociale qui entoure ce droit. C’est ce que défend le positivisme juridique, dont l’objectif est de décrire le plus justement possible l’état du droit dans une société donnée, de distinguer ce qui est « légal » et ce qui ne l’est pas. L’objectivité est alors atteinte par l’identification rigoureuse et méthodique du droit existant. A première vue, cela ne semble pas poser d’énormes problèmes dans la mesure où il s’agit d’une entreprise avant tout descriptive. En réalité, la quête d’objectivité est plus complexe qu’il n’y paraît.
Lorsqu’on traite un sujet « macro », on se heurte au problème de la quantité de textes qu’il convient d’analyser pour parvenir à une description la plus juste possible. Il n’est alors pas possible de faire une analyse de régression, comme on le ferait dans le cadre d’une recherche quantitative en science politique, par exemple. Il peut être tentant de résoudre ce problème en s’appuyant sur des exemples plutôt qu’une analyse systématique. A défaut de pouvoir appréhender la totalité des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), on se contentera d’utiliser un petit nombre d’arrêts marquants. Ceci a du sens dès lors qu’il s’agit d’identifier les « grands arrêts », ceux qui ont changé l’état du droit. Mais bien souvent on court le risque de tirer des conclusions générales (par exemple : la CJUE est une juridiction qui privilégie le marché par rapport aux droits sociaux) en se basant sur quelques cas allant dans ce sens (les fameux arrêts Viking et Laval de 2007), sans être certain que l’ensemble de la jurisprudence est conforme à ces quelques cas. Pour satisfaire à l’exigence d’objectivité, il faut, selon moi, privilégier l’analyse systématique des sources, et éviter d’apporter une pseudo preuve basée sur de simples exemples.
Lorsqu’on traite un sujet plus « micro », d’autres problèmes demeurent. La principale difficulté est liée au fait que le droit est sujet à interprétation. Par exemple, comment interpréter le second amendement de la Constitution américaine qui consacre le droit du peuple de détenir et de porter des armes ? Signifie-t-il que le peuple, de manière collective, a le droit de défendre l’État contre d’éventuelles attaques, ou que chaque citoyen, de manière individuelle, peut utiliser des armes pour se défendre contre d’autres citoyens ? In fine, l’interprétation peut être fournie par le juge dans le cadre des litiges qui sont portés devant lui. Ainsi la Cour suprême des États-Unis, en 2008, a-t-elle considéré que le second amendement renferme un droit individuel à la détention d’armes. A ce stade, la doctrine positiviste cherchera à vérifier la validité du raisonnement utilisé par le juge pour délivrer son interprétation. Dans notre exemple, elle se demandera : la Cour suprême a-t-elle fait une interprétation du second amendement conforme à la logique du droit ? Pour moi, il y a là, de la part du juriste « positiviste », une prétention à l’objectivité qui n’est pas tenable. Il n’est pas possible d’affirmer, au nom de l’objectivité, que « le juge s’est trompé », parce qu’il aurait appliqué un « mauvais » raisonnement. Je rejoins en cela le courant réaliste du droit selon lequel l’interprétation est avant tout une question de volonté : il n’existe pas une seule interprétation possible du droit (celle que la logique juridique indiquerait), mais plusieurs, parmi lesquelles le juge fait un choix (dans une certaine mesure « politique »).
Une seconde approche au sein de la discipline juridique, celle à laquelle je me rattache, analyse le droit en prenant en considération la manière dont il interagit avec la société. L’identification du droit existant reste un objectif important, mais elle prend place dans un ensemble de considérations plus vastes et crée des ponts avec les autres sciences sociales. La prise en compte de ces considérations aboutit parfois à des analyses qui ne cherchent pas l’objectivité mais sont au contraire de nature normative (le juriste donne son avis personnel sur la norme de droit, son contenu, son impact supposé sur la société) ou prescriptive (le juriste donne son avis personnel sur ce que le droit devrait être, comment il devrait évoluer).
Toutefois, il est possible -et selon moi souhaitable- de traiter les rapports entre droit et société sans pour autant renoncer à l’objectivité, et en écartant au maximum les jugements de valeur. On cherche alors à comprendre d’où vient le droit, comment il est généré, comment il évolue, à vérifier s’il est appliqué, à analyser ce que les acteurs font du droit, sans forcément chercher à l’approuver ou le désapprouver. La recherche d’objectivité passe, comme pour les autres sciences sociales, par l’administration de la preuve. Elle suppose l’établissement des faits fondé sur la diversité et l’analyse systématique des sources. Elle passe aussi, bien que ce soit très rare en droit, par la recherche de causalités, l’élaboration d’hypothèses mettant en relation plusieurs variables, faisant le lien entre causes et effets.
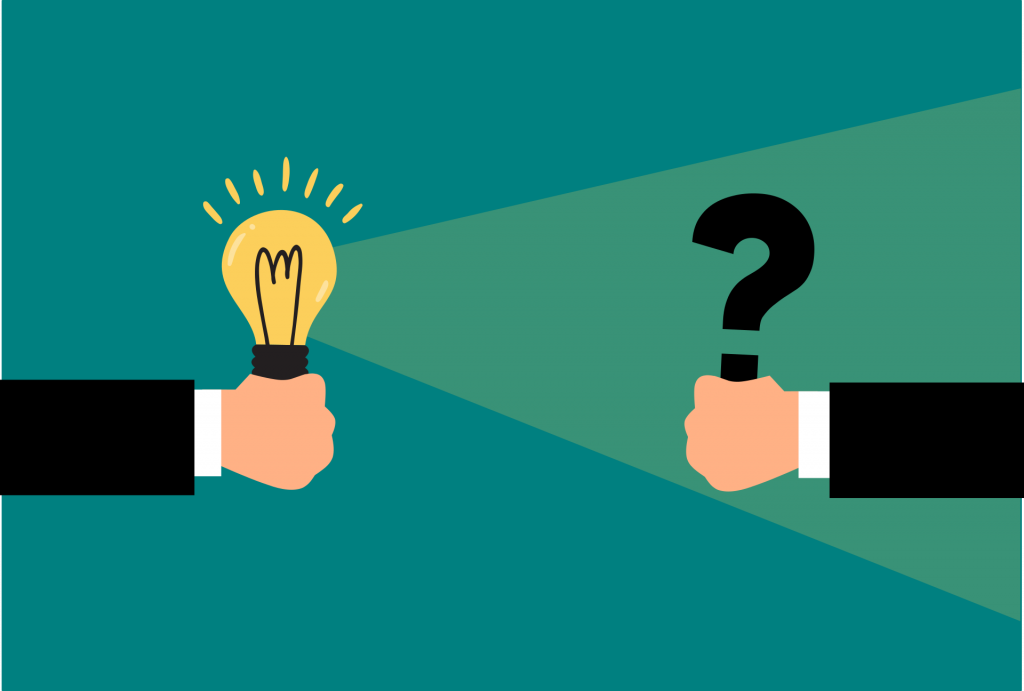
La neutralité du chercheur est-elle possible et souhaitable ?
La neutralité totale est impossible, mais il reste souhaitable de tendre vers la plus grande neutralité. Il faut cependant distinguer le choix de l’objet de recherche et la manière de le traiter. Le choix de l’objet peut être lié aux valeurs que l’on défend. De nombreux chercheurs s’intéressent aux droits humains et aux discriminations, parce qu’ils estiment que ces droits doivent être défendus et ces discriminations combattues. Dès lors qu’ils font un traitement objectif et non militant de ces questions (voir réponse à la première question), cela ne pose pas problème. Ce traitement sera d’autant plus objectif que des méthodes scientifiques seront utilisées (voir réponse à la troisième question). Qu’un chercheur entende démontrer tel ou tel point parce que cela sert ses opinions n’est pas en soi problématique. Cela ne le devient que si le chercheur refuse que le résultat de sa recherche contredise ses opinions.
Au-delà de cette distinction fondamentale entre choix et traitement, plusieurs difficultés peuvent se présenter. Tout d’abord, le choix d’un objet de recherche par les chercheurs est parfois source de préjugés, dans la communauté scientifique ou dans l’espace public. Ainsi les chercheurs travaillant sur les questions de sécurité et de défense sont parfois perçus comme bellicistes et peu attentifs aux droits humains. De même, celles et ceux qui travaillent sur les discriminations à raison de l’appartenance religieuse (réelle ou supposée) sont parfois présenté-e-s comme complaisants à l’égard des religions, même lorsqu’elles prennent des formes violentes ou discriminatoires. En retour, ceux et celles qui s’intéressent aux discriminations ayant pour source la religion sont parfois vus comme faisant le lit des discriminations à raison de la religion. Ce qui permet de tordre le cou à ces préjugés, c’est le traitement objectif et méthodique du sujet de recherche, l’absence de propos normatif, le rejet des jugements de valeur.
Une autre difficulté peut provenir de l’orientation de la recherche dans une société donnée (la France, l’Europe, l’Occident…) Certains sujets peuvent faire l’objet d’un traitement de grande ampleur alors que d’autres sont délaissés, ce qui peut laisser penser que la communauté scientifique est biaisée, qu’elle incline plus vers tel type de thématique que telle autre. C’est en acceptant et défendant le pluralisme -dans les limites de la loi- qu’on peut éviter cet écueil.
Enfin, on soulignera l’ambiguïté qui peut résulter des activités connexes du chercheur : la prise de parole publique liée à un engagement personnel ; la réponse aux sollicitations des médias…. Ces activités sont de nature à semer le doute sur la neutralité des travaux des chercheurs. Il faut donc faire en sorte – si on prétend à l’objectivité et à la neutralité dans le traitement de sa recherche – de cloisonner recherche et activités connexes. Cela n’est pas évident. On peut, en effet, vouloir utiliser les résultats d’une recherche en soutien de telle ou telle opinion. Or, lorsqu’on se situe sur les deux terrains – celui de la recherche, celui de l’engagement dans la Cité – il faut accepter le doute que cela fait naître dans l’esprit du public, qui peut légitimement se demander si telle recherche est objective ou avant tout militante.
A minima, il convient de toujours clarifier le registre dans lequel on se situe : normatif ou analytique. Lorsque je réponds à une interview, j’essaie généralement d’éviter les questions de nature normative (que pensez-vous de… ? Est-ce bien ou mal… ?) ce qui fait de moi un « mauvais client » pour les médias. Lorsque j’enseigne, j’essaie d’éviter au maximum tout jugement de valeur, et dans les (rares) cas où je suis amené à délivrer une opinion, souvent à l’invitation d’un ou d’une étudiante, je précise bien qu’il s’agit d’une opinion et que chacun est libre d’avoir les siennes.
Quelle place les méthodes occupent-elles dans votre démarche de chercheur ?
La rigueur méthodologique est essentielle. C’est en indiquant de manière précise comment on est parvenu à un résultat qu’on apporte la meilleure garantie de son objectivité. En expliquant la méthode utilisée, on s’ouvre à la critique d’autres chercheurs, lesquels, en affinant ou modifiant la méthode, parviendront peut-être à des résultats plus justes. Cette critique est indispensable à la science.
J’ai abordé plus haut certaines difficultés méthodologiques auxquelles est confronté le juriste, en distinguant niveaux « macro » et « micro », et en évoquant l’interprétation du droit. J’ai aussi évoqué la nécessité d’éviter la « démonstration » par l’exemple et de privilégier l’analyse systématique des sources. J’aimerais insister par ailleurs sur un point tout aussi crucial, en droit et dans d’autres disciplines : la définition et l’usage des notions.
Les notions sont des outils qui servent l’analyse et non des réalités intangibles. Elles servent à établir des faits, mais ne doivent pas être confondues avec les faits eux-mêmes. Prenons pour exemple la notion de constitution. Certains juristes soutiendront qu’il ne peut exister de constitution européenne parce qu’une constitution ne peut exister que dans le cadre de l’Etat nation. Ceci est totalement juste … si on considère qu’une constitution ne peut exister que dans le cadre d’un Etat nation ! Si on écarte ce critère, pour en retenir d’autres (la charte supérieure d’une organisation, répartissant les pouvoirs entre institutions, établissant une liste de principes supérieurs…), dans ce cas on peut tout à fait envisager l’existence de constitutions au niveau de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales.
Les notions ne sont pas, en soi, scientifiques ou non scientifiques. Toute notion peut trouver place dans une démarche scientifique à condition d’être clairement définie et utilisée dans une logique d’établissement objectif des faits. Ainsi, pour que le débat sur le caractère démocratique ou non démocratique de l’Union européenne soit « scientifique », il faut a minima s’entendre sur ce que l’on entend par démocratie, déterminer les critères de la démocratie, trouver les indicateurs qui permettent d’établir si l’Union européenne satisfait ou non à tel ou tel critère. On aboutira alors au résultat le plus juste possible en fonction des critères choisis ; sachant que si les critères changent, le résultat est aussi susceptible de changer. Un juriste choisissant des critères formels (élection au suffrage universel, séparation des pouvoirs, protection des droits fondamentaux…) trouvera qu’il existe une démocratie européenne là où une autre, insistant sur des critères informels (vie politique à l’échelle européenne, participation électorale…), en montrera plus facilement les limites.
Pourriez-vous présenter un exemple de recherche, idéalement issue de vos propres travaux, pour illustrer les enjeux et les tensions autour de l’objectivité et de la neutralité en sciences sociales ?
Dans notre travail sur la Cour de justice de l’Union européenne, Sabine Saurugger et moi-même utilisons la notion d’activisme. Cette notion n’est pas sans poser problème car elle est parfois utilisée par des auteurs qui lui donnent une connotation négative. L’activisme de la Cour est alors vu comme le reflet d’une sorte de gouvernement des juges, une situation où les juges iraient au-delà de leur fonction d’application et d’interprétation du droit pour se substituer au pouvoir dit politique (gouvernement, parlement). Or, notre objectif n’est pas de dénoncer un pouvoir supposé trop important de la Cour, mais d’analyser sa place dans le système politique de l’UE, en laissant le soin au lecteur de décider si cette place est insuffisante, normale ou excessive. Pour ce faire, nous donnons une définition de l’activisme liée à deux éléments principaux (le type d’interprétation délivrée, et l’écart entre cette interprétation et la position des autres acteurs du système européen). Cette définition ne comporte ni approbation ni désaveu de la Cour, elle n’est qu’un outil d’analyse.
Un théoricien critique du droit dirait que le simple fait de ne pas chercher à critiquer la Cour est une prise de position politique, au moins implicite, en faveur de la Cour. Ce n’est pas mon avis. Pour moi, la quête d’objectivité suppose de trouver son chemin entre deux positions opposées. La première consiste à décrire les arrêts de la Cour sans jamais s’interroger à leur propos, sans aucune mise en perspective. La seconde suppose au contraire une critique constante de la Cour sur la base de postulats le plus souvent normatifs, voire idéologiques. Entre ces deux positions, il y a la place pour des analyses qui décrivent le plus objectivement possible les arrêts de la Cour, qui déterminent s’ils sont ou non « activistes », qui cherchent à comprendre d’où ils viennent, s’ils sont acceptés ou contestés, et ce qui explique qu’ils soient acceptés ou contestés. En somme, des analyses qui ne présentent pas les positions de la Cour comme une sorte de vérité juridique que l’on ne saurait interroger, sans pour autant l’appréhender sur le mode de la critique normative.